Khadija, une femme puissante
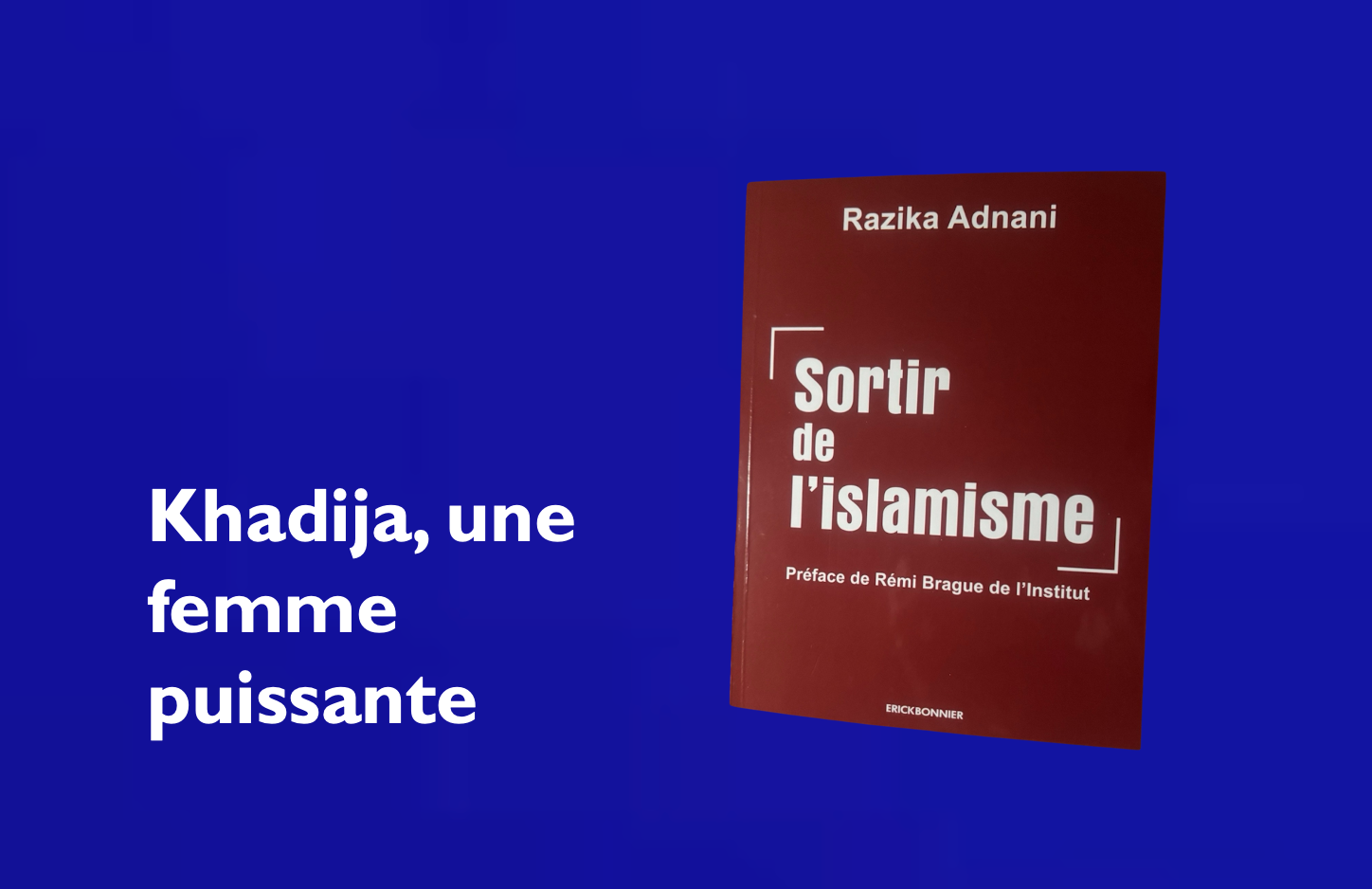
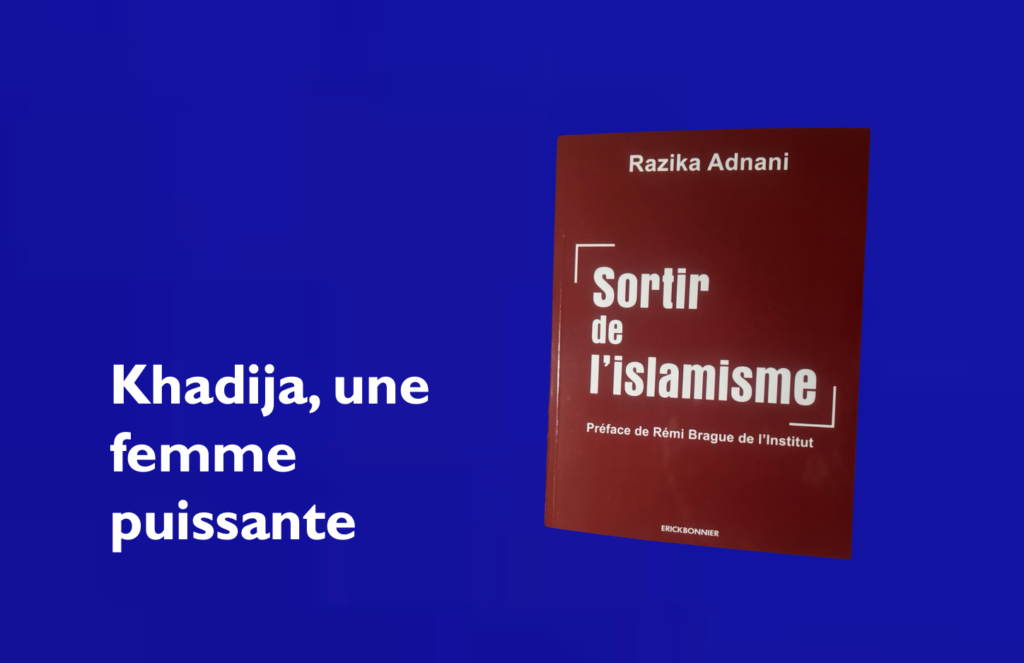
Extrait de l’ouvrage de Razika Adnani Sortir de l’islamisme paru aux éditions Erick Bonnier
À La Mecque, en l’an 595, dans une maison vaste et somptueuse, Khadija bint (fille de) Khuwaylid, une grande commerçante qorayshite de 35 ans environ, mère de plusieurs enfants, se prépare à recevoir Abou Talib et son jeune neveu Mohammed qu’elle a demandé en mariage. Elle l’avait engagé il y a quelque temps pour conduire son commerce caravanier vers la Syrie et elle a décidé de l’épouser. De la cuisine, où le mouton tué pour l’occasion est en train de cuire avec d’autres nombreux plats, se dégage une odeur délicieuse. Dans la grande salle joliment décorée où la finalisation de la demande en mariage aura lieu, l’oncle de Khadija, Amru ibn Asad, est déjà installé sur des peaux de moutons et de chameaux posées à même le sol. Nufaysa bint Muniyah, la femme de compagnie de Khadija, celle qu’elle a envoyée pour transmettre à Mohammed son désir de se marier avec lui, s’occupe des enfants de Khadija.
Sur le visage de son oncle, Khadija remarque que celui-ci n’est toujours pas convaincu par la liaison de mariage qu’elle veut entreprendre. Il pense que le jeune Mohammed, âgé à peine de 25 ans, ne correspond pas au rang social de sa nièce. Il lui a maintes fois répété qu’elle était une femme de la grande tribu des Banu Asad, qu’elle était riche et que beaucoup d’hommes, des seigneurs de leur clan, avaient exprimé leur souhait de se marier avec elle si elle était intéressée par le mariage. Khadija est riche, a une grande maison et un florissant commerce. Elle peut épouser qui elle veut sans avoir à craindre pour son avenir ni pour celui de ses enfants.
Ce petit récit inspiré de la vie de Khadija telle qu’elle est racontée par les biographes musulmans montre que les femmes arabes avant l’islam jouissaient d’une grande liberté et disposaient d’un considérable statut social. Même aujourd’hui, des femmes qui osent demander un homme en mariage, de surcroît beaucoup plus jeune qu’elles, sont très rares.
Après son mariage avec Mohammed, Khadija a continué à être une femme de pouvoir et de décision. Lorsque son époux lui a fait part de ce qu’il avait vécu dans la grotte de Hira, selon le discours religieux, c’est elle qui a pris la décision de l’emmener voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, un érudit nestorien ou nazaréen, pour les conseiller. Le comportement de Khadija ne peut émaner que d’une femme disposant d’une grande liberté et d’un statut social considérable lui procurant confiance en elle et sa capacité à prendre des décisions.
Quand l’histoire est faite par les religieux
Cette histoire de Khadija tranche totalement avec le discours religieux qui affirme qu’avant l’islam, la femme en Arabie n’avait aucun statut social ni juridique. Ainsi, au sujet de l’héritage, ils répètent qu’elle n’avait aucun droit à l’héritage, ce qui ne correspond pas à la vie de Khadija qui avait hérité sa fortune, selon eux, de ses deux premiers époux. Il est possible qu’elle l’ait héritée de ses parents. L’important est que cela constitue une preuve que la femme arabe avant l’islam avait le droit à l’héritage. La vie de Mohammed avec Khadija montre également que celui-ci était entretenu par sa femme jusqu’à la mort de Khadija en 619, ce qui est une preuve que les hommes n’étaient pas toujours ceux qui disposaient de l’argent et qui le dépensaient pour entretenir les femmes comme on le lit dans le verset 34 de la sourate 4, Les Femmes, qui appartient à la période de Médine, et comme l’expliquent les commentateurs tels que le Tunisien Tahar Ben Achour (1879-1973). Pour lui, le fait que ce soient les hommes qui dépensent leur argent pour entretenir les femmes est une chose qui a toujours existé dans les sociétés humaines.
Razika Adnani, Sortir de l’islamisme, Erick Bonnier, 88-90.
2 Commentaire(s)
Votre réflexion sur la maîtrise du corps et du désir m’évoque une que j’avais trouvé assez empreinte de bienveillance et d’amour, une réalité souvent ignorée : depuis Khadija, à mon avie, elle a ‘viat pu impulser d’ autres les femmes dans un mode vie eu ce rôle que vous décrivez d’elle est resté bien plus actifs qu’on ne veut l’admettre aujourd’hui, avec tout le “Inhiraf”ou bien” Ataharrouf” me semble un adjectif approprié. Certes, cette liberté a perduré, mais dans un cadre social précis, selon une certaine éthique et un rang déterminé.
Un exemple frappant que je connais : une jeune fille née en 1939, fille de bachaga, avait le privilège rare de choisir son époux. Lors des grandes fêtes et cérémonies, cachée derrière un moucharabieh, elle observait les prétendants avant de désigner celui qu’elle voulait épouser. Ce n’était pas une exception isolée : dans certaines tribus, la femme occupait même la place de chef de famille, un rôle volontairement occulté pour ne pas bousculer l’ordre patriarcal.
Dès que son choix fut fait, elle convoqua son père, et ensemble, ils validèrent la première étape de la négociation, scellant ainsi son avenir selon les usages de leur rang.
Pourquoi, en 2025, assistons-nous à une régression plutôt qu’à une évolution? À une mainmise toujours plus forte sur lesfemmes ?
Comment en est-on arrivé à troquer une spiritualité tournée vers l’élévation de l’âme contre une vision où l’homme impose sa loi et la femme, reléguée à l’arrière-plan, devient prisonnière de son propre corps ?
Votre ouvrage Sortir de l’islamisme ouvre la voie à une réconciliation essentielle avec ces vérités historiques.
Femmes Musulmanes de France, voilées ou non, devons investir plus souvent des espaces de réflexion. Il faut aussi inclure d’autres religions Chrétienne et Judaïque
En Jordanie, j’ai ressenti une telle richesse dans le partage des savoirs que cela m’en a bouleversée. Là-bas, des femmes issues de diverses tribus, d’autres Chrétienne elles tissent ensemble un maillage solide, bâtissent des associations en commun aux côtés des hommes une société fondée sur le partage et l’équilibre. Une force qui donne envie de pleurer, non de tristesse, mais d’espoir.
À noter que des initiatives récentes cherchent à promouvoir l’égalité dans l’héritage. En mai 2023, onze Églises de Jordanie ont approuvé un texte commun visant à garantir l’égalité successorale entre hommes et femmes chrétiens.
En Jordanie, le droit successoral est principalement régi par la loi islamique sunnite, qui stipule que les femmes héritent généralement de la moitié de la part des hommes. Par exemple, une sœur reçoit la moitié de la part de son frère, et une veuve hérite d’un huitième des biens de son époux si elle a des enfants, ou d’un quart si elle n’en a pas.
Cependant, au-delà des dispositions légales, des pressions sociales peuvent amener certaines femmes à renoncer à leur part d’héritage en faveur des hommes de la famille. Cette pratique est souvent intériorisée, renforçant ainsi les privilèges masculins en matière de succession.
À noter que des initiatives récentes cherchent à promouvoir l’égalité dans l’héritage, la Jordanie étant principalement Sunnite. Pourtant en mai 2023, onze Églises de Jordanie ont approuvé un texte commun visant à garantir l’égalité successorale entre hommes et femmes chrétiens. Bien que ce document doit encore être validé par le gouvernement et le parlement, il représente une avancée significative pour les droits des femmes chrétiennes en Jordanie. Il impulsera assurément une volonté d’influer des efforts pour promouvoir uniformément la Charia et ainsi une répartition plus équitable de l’héritage entre femmes et hommes Musulmans en Jordanie.
.