Parole à Razika Adnani – Sortir de l’islamisme
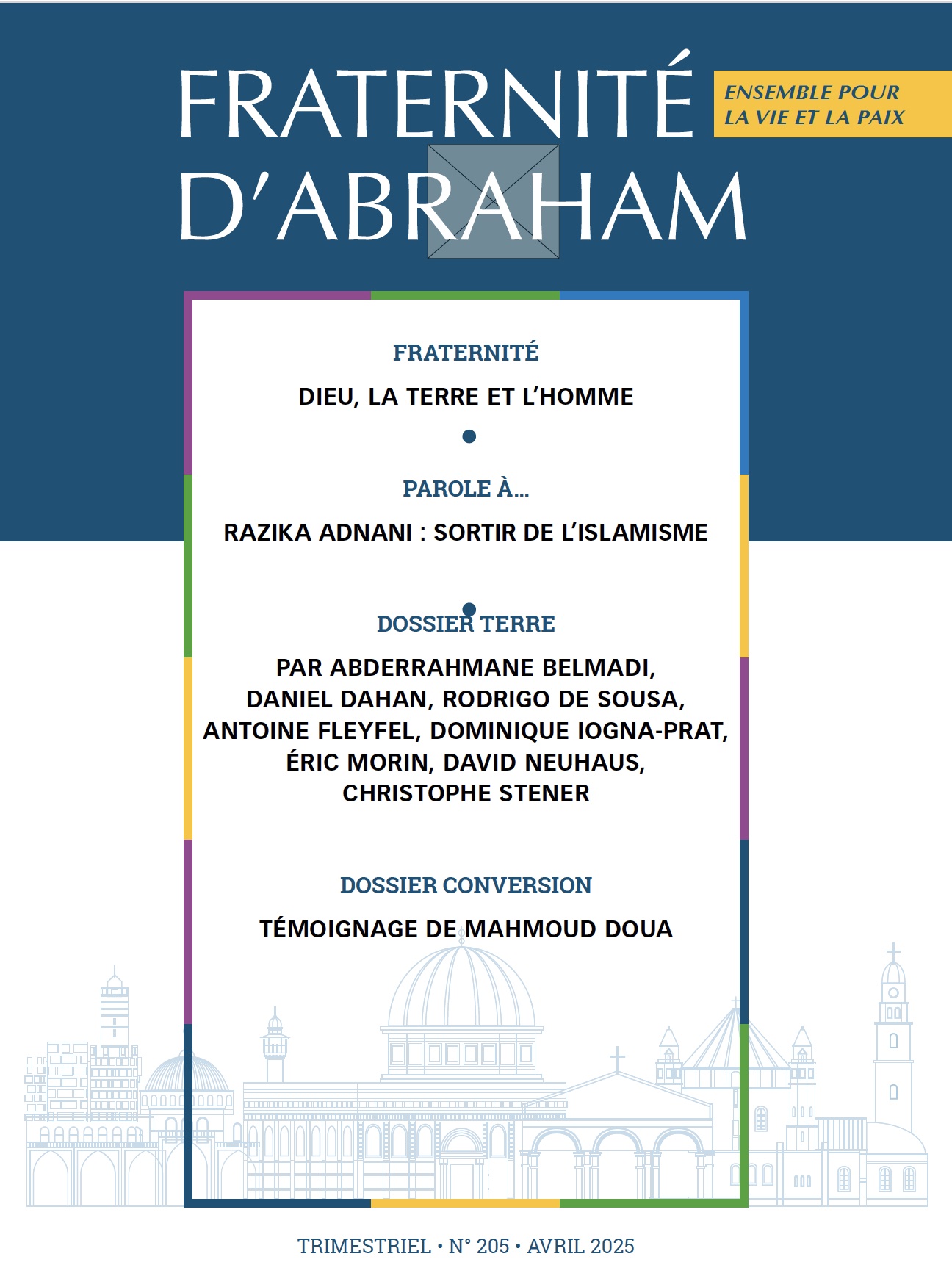
Sortir de l’islamisme – Entretien avec Michel Rostagnat. Revue Fraternité d’Abraham, numéro 205, avril 2025.
Razika Adnani est philosophe, islamologue et conférencière franco-algérienne. Elle a publié plusieurs articles de presse et ouvrages dont le dernier, Sortir de l’islamisme paru en décembre 2024 aux éditions Erick Bonnier, préfacé par Rémi Brague.
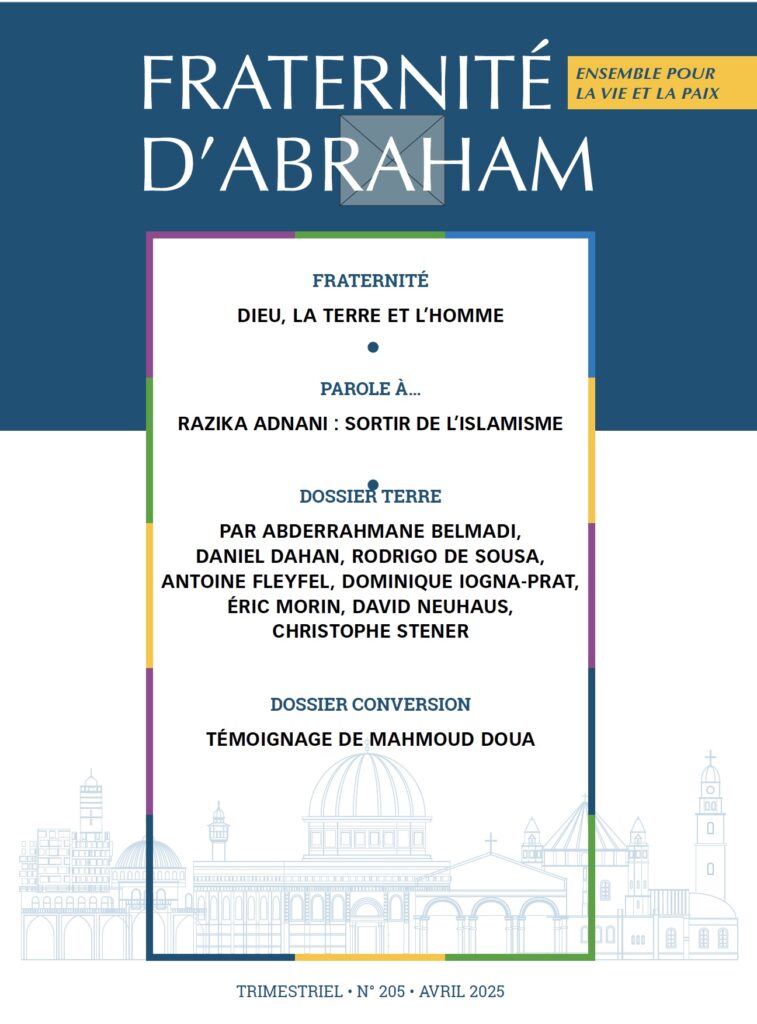
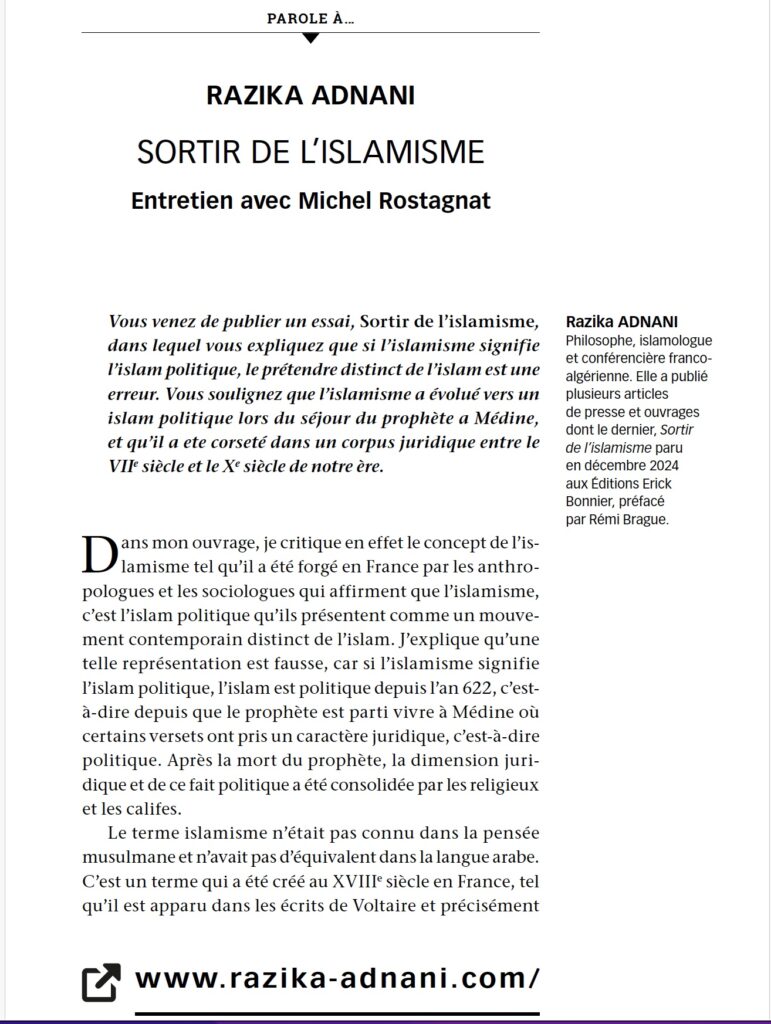
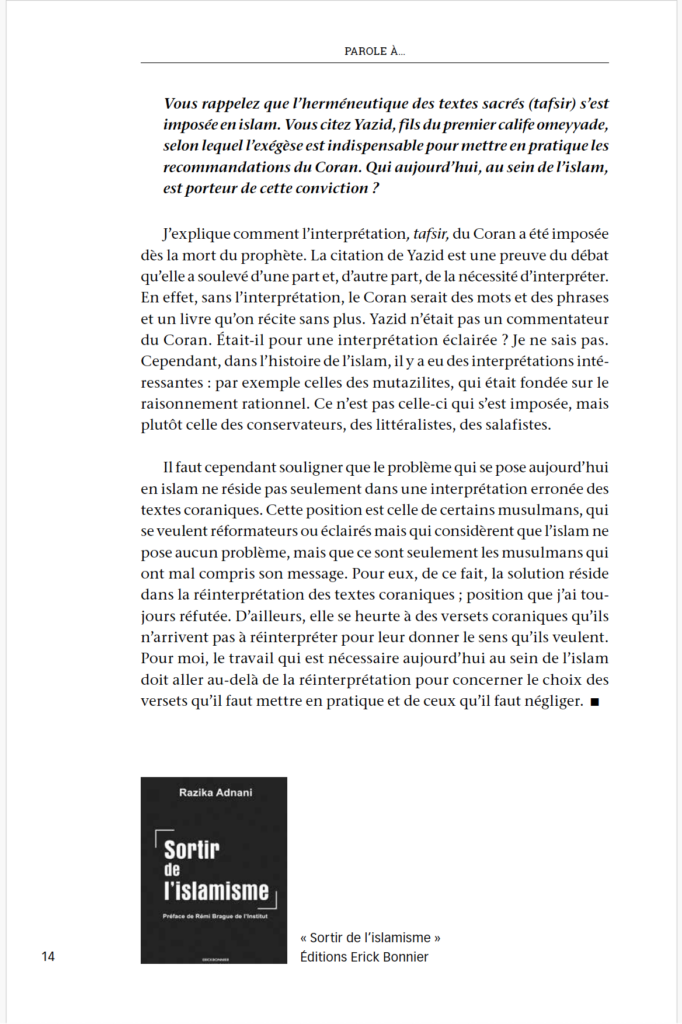
Fraternité d’Abraham – Vous venez de publier un essai, Sortir de l’islamisme, dans lequel vous expliquez que si l’islamisme signifie l’islam politique, le prétendre distinct de l’islam est une erreur. Vous soulignez que l’islamisme a évolué vers un islam politique lors du séjour du prophète a Médine, et qu’il a ete corseté dans un corpus juridique entre le VIIe siècle et le Xe siècle de notre ère.
Razika Adnani – Dans mon ouvrage, je critique en effet le concept de l’islamisme tel qu’il a été forgé en France par les anthropologues et les sociologues qui affirment que l’islamisme, c’est l’islam politique qu’ils présentent comme un mouvement contemporain distinct de l’islam. J’explique qu’une telle représentation est fausse, car que si l’islamisme signifie l’islam politique, l’islam est politique depuis l’an 622, c’est-à-dire depuis que le prophète est parti vivre à Médine où certains versets ont pris un caractère juridique, c’est-à-dire politique. Après la mort du prophète, la dimension juridique et de ce fait politique a été consolidée par les religieux et les califes.
Le terme islamisme n’était pas connu dans la pensée musulmane et n’avait pas d’équivalent dans la langue arabe. C’est un terme qui a été créé au XVIIIe siècle en France, tel qu’il est apparu dans les écrits de Voltaire et précisément dans son essai Le fanatisme ou Mahomet le prophète,pour désigner tout simplement la religion musulmane. Autrement dit, il était l’équivalent du terme arabe islam. Il n’a pris le sens d’islam politique avec la précision qu’il n’était pas l’islam qu’au début des années 1980 ; alors que cette distinction n’a aucun fondement théologique ni historique. Les musulmans encore aujourd’hui, hormis certains qui vivent en Occident, ne parlent pas d’islam et d’islamisme. Pour eux, il y a un islam qui n’est pas dissocié de sa dimension politique. C’est donc étrange qu’en Occident on monte en épingle cette polémique sur la distinction entre islamisme et islam. Si l’islamisme signifie l’islam politique, l’islam est politique depuis l’an 622, c’est-à-dire depuis que le prophète est parti vivre à Médine.
Cette conception du terme islamisme comme islam politique qui n’est pas l’islam s’explique uniquement par le souci du politiquement correct, dans l’objectif de préserver la sensibilité des musulmans, chez ceux qui étudiaient les mouvements politico-religieux et le phénomène de la montée, au début des années 1980, d’un islam politique traditionnel et rigoriste. Là aussi, ce sont des propos que l’histoire de l’islam ne valide pas, étant donné que les mouvements politico-religieux ont toujours existé dans l’histoire de l’islam, tels que les kharijites, les chiites et les almoravides. Certains ont fini par prendre le pouvoir comme c’est le cas aujourd’hui de Daech, des Frères musulmans ou encore de Hayat Tahrir al-Cham en Syrie.
Les universitaires qui ont étudié le phénomène de l’islam politique, au lieu de prendre en compte ce que dit la réalité théologique et historique de l’islam, ont préféré se laisser guider par leur positions politiques, ce qui est dramatique au pays de Descartes, de Gaston Bachelard, de Claude Bernard et de Durkheim, ces grands esprits qui se sont efforcés de mettre en place les principes de l’esprit scientifique.
F.A- Existe-t-il encore dans l’islam, bien après la regrettée nahda, la renaissance arabe du XIXe siècle, des courants et des croyants qui souhaitent privilégier la dimension mystique de leur foi, en acceptant sans état d’âme de vivre sous des lois laïques ?
Razika Adnani – Non, la législation n’a pas éclipsé la Révélation. Certaines règles de cette législation existent dans le Coran qui est pour les musulmans un livre révélé. Le Droit musulman, qu’on appelle aujourd’hui dans sa totalité la charia, ce qui n’était pas le cas dans le passé, a été présenté dansle discours religieux comme étant lui-même révélé alors que beaucoup de ses règles ont été établies par les musulmans lors des premiers siècles de l’islam. Les juristes musulmans ont utilisé pour des besoins souvent politiques la Révélation pour imposer leur législation.
Dans la pensée musulmane, une position qui revendique un islam uniquement spirituel, autrement dit sans sa dimension juridique et politique, existe. Elle remonte au VIIIe siècle lorsqu’à Bassora en Irak des nouveaux convertis, encore très imprégnés des différentes doctrines religieuses et philosophiques présentes dans la région, ont revendiqué un islam uniquement spirituel. Elle a conduit à l’apparition du soufisme. Toutefois, confrontés à l’islam des juristes qui a fini par s’imposer vers le XIIe siècle, les soufis ont fini par reconnaître la charia. Ainsi, le grand soufi al-Ghazali, mort en 1111, était en même temps un grand juriste.
La nahda a essayé de son côté de libérer le Droit de la religion, ce qui aurait amené à faire de l’islam une spiritualité et non une organisation sociale. Cependant, la nahda a fini elle aussi par échouer face aux conservateurs et on assiste aujourd’hui même à un retour de plus en plus marquant aux règles de la charia les plus rétrogrades. L’histoire des musulmans est un éternel retour au passé. Chaque tentative d’émancipation est réprimée par les conservateurs. Au XXe siècle, ils ont été beaucoup aidés par des universitaires français avec la création et la définition du concept de l’islamisme, car ce terme a comme objectif de mettre l’islam à l’abri de tout esprit critique et de le présenter comme exempt de toute responsabilité quant aux problèmes qui se posent, ce qui a fait le lit des islamistes et des conservateurs. Aucun problème ne peut être réglé si l’on ne prend pas conscience de son existence. Les conservateurs ont été beaucoup aidés au XXe siècle par les universitaires français avec la création et la définition du concept de l’islamisme.
F.A – Notre revue a consacré un numéro à la question des conversions, en y donnant la parole à des personnes que leur itinéraire spirituel a conduit à librement embrasser une nouvelle religion, sans nécessairement abandonner ce qu’elles tenaient de leur ancienne religion. Nous avons été très émus à lire ces itinéraires croisés. Est-il possible à votre avis que l’islam reconnaisse la liberté pour ses ressortissants de se tourner vers une nouvelle religion ?
Razika Adnani – non. Le discours religieux, dominant dans l’islam auquel se référent les législateurs dans les pays musulmans, n’accepte pas la liberté de conscience. Pourtant, le Coran comporte plusieurs versets, j’en ai compté 28, qui permettent de déduire qu’il garantit la liberté de croyance. Or, ces versets ont été, dès les premiers siècles de l’islam, ignorés et d’autres ont été pris en compte pour justifier le fait de ne pas reconnaître la liberté de croyance. Ibn Hazm (994-1064), théologien et philosophe andalou, issu d’une famille chrétienne convertie à l’islam, était d’avis que la liberté de conscience nuirait à la cohésion de la société musulmane en se justifiant par « le consensus » des premiers juristes. Quand on lui opposa le verset bien connu « Nulle contrainte en islam », il rétorqua qu’il ne s’adressait qu’aux non-musulmans et c’est l’explication de ce verset dominante encore aujourd’hui parmi les musulmans.
Ibn Hazm (994-1064), théologien et philosophe andalou, issu d’une famille chrétienne convertie à l’islam, était d’avis que la liberté de conscience nuirait à la cohésion de la société musulmane en se justifiant par « le consensus » des premiers juristes. Quand on lui opposa le verset bien connu « Nulle contrainte en islam », il rétorqua qu’il ne s’adressait qu’aux non-musulmans.
Au début du XXe siècle, les musulmans voulant se moderniser ont reconnu dans leurs constitutions la liberté absolue de croyance. Ce fut le cas en Irak (1925), Syrie (1930), Egypte (1923), Algérie (« liberté de conscience » en version française, en 1975). Mais ensuite, tous ces pays l’ont supprimée : Irak (1958), Égypte (1971), Lybie (1968), Algérie (2020). J’explique cela par le fait que cette reconnaissance était une volonté politique et non religieuse. Une des causes de l’échec de la nahda, comme je l’explique dans mon ouvrage, est de n’avoir pu faire le travail nécessaire au sein de l’islam, c’est-à-dire le réformer, ce qui explique que les conservateurs ont pu facilement culpabiliser les musulmans en leur racontant qu’ils étaient éloignés de l’islam.
F.A- Le numéro que vous allez ouvrir s’intéresse à la relation que nos religions entretiennent entre Dieu, l’homme et la terre qui lui est confiée. En observant l’échiquier géopolitique actuel, on a l’impression que les forces politiques soutenues par des Etats à majorité musulmane visent plutôt l’expansion territoriale et la lutte contre les infidèles, ou a minima leur anesthésie intellectuelle, chez nous, comme en témoigne la visibilité croissante du voile dans l’espace public, que leur conversion. L’islam aurait-il renoncé à s’adresser aux habitants de cette terre non encore acquis à son message ?
Razika Adnani –En islam, l’idée qu’à la fin des temps la terre entière sera convertie à l’islam fait partie du dogme tel que les musulmans le conçoivent. Dans la pensée musulmane, convertir l’autre est un devoir religieux et la protection de la religion est un fondement du Droit musulman auquel se réfèrent beaucoup les législateurs dans les pays musulmans. En Algérie, l’article 144 bis 2 du code pénal promulgué le 26 juin 2001 prévoit 3 à 5 ans de prison ferme contre « quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’islam ». Ce genre de punition existe dans presque tous les pays musulmans. En Iran, on condamne à mort des hommes et des femmes accusés de provoquer le désordre sur Terre. Avec ce genre de lois, tout comportement qui n’est pas conforme au discours religieux et à sa manière de concevoir la religion est réprimé. Il est évident que pour les religieux, ce qu’ils considèrent comme étant l’intérêt de la religion est plus important que le bien être des individus.
La liberté de conscience n’a pas été retenue par les juristes musulmans, car elle comporterait le risque de nuire à l’islam et aux sociétés musulmanes. En réalité, le juriste ne détient pas la vérité religieuse et, selon le dogme de l’islam, aucun être humain ne peut accéder à la vérité sacrée et absolue, car seul Dieu est parfait et Dieu est unique. Or, l’État, qui punit les individus parce qu’ils n’ont pas la même idée de la religion que lui, prétend détenir la vérité sacrée et absolue et se met de ce fait au même niveau que Dieu. Autrement dit, c’est l’État ou le législateur qui pense protéger la religion qui nuit à la religion. Par ailleurs, sur le plan politique, le juge qui s’applique à protéger la religion dérape de sa fonction qui consiste à légiférer pour le bien-être des individus et de la société, et à préserver les droits et libertés des femmes et des hommes. Le rôle du législateur n’est pas non plus de s’occuper de ce que pourraient être les sentiments des prophètes qui sont morts il y a des siècles, ni des convictions religieuses ou non religieuses des personnes. Aujourd’hui, presque tous les jeunes dans les sociétés musulmanes rêvent de quitter leur pays pour aller vivre ailleurs, notamment en Occident. C’est une des conséquences de cet excès de religiosité des pouvoirs et des sociétés qui ont le souci de protéger l’islam davantage que les droits des individus. En réalité, le législateur ne détient pas la vérité religieuse et, selon le dogme de l’islam, aucun être humain ne peut accéder à la vérité sacrée et absolue, car seul Dieu est parfait et Dieu est unique.
F.A – Vous dénoncez la schizophrénie des salafistes qui refuseraient toute adaptation du message prophétique à la vie du monde moderne tout en se satisfaisant des possibilités nouvelles que lui offre la technologie. Pourtant, dans le Coran, Dieu rappelle à plusieurs reprises qu’il a annoncé son message « en langue arabe claire pour qu’ils comprennent » ; ce qui pourrait s’interpréter dans le sens où aujourd’hui, en France, il parlerait français, en Indonésie indonésien, etc. ; donc qu’il se prêterait à l’interprétation dans la culture du peuple qui le reçoit. Qu’en pensez-vous ?
Razika Adnani – En effet, le Coran s’adresse aux Arabes en langue arabe pour qu’ils puissent le comprendre comme lui-même le précise. Le terme langue peut être pris ici dans un sens large pour désigner toute la culture transmise par la parole. Cela signifie que le message coranique lui-même reconnaît qu’il s’inscrit dans la réalité historique et sociologique de l’époque et que par conséquent, ses règles ne peuvent pas s’appliquer éternellement à toute l’humanité. Or le discours religieux prétend que les règles qui ont organisé la société de Médine aux VIIe siècle sont valables en tout temps. Autrement dit, il les place en dehors du temps et du lieu. Pour convaincre du caractère de l’immuabilité des règles de la charia coranique, les théologiens ont mis en place la théorie du Coran incréé. Quant au fait que le Coran soit en langue arabe, ils expliquent cela par le fait que Dieu lui-même parle l’arabe et que c’est dans sa langue à lui qu’il a révélé le Coran. Selon eux, Dieu s’adresse à l’humanité dans la langue arabe qui est la sienne. Cela nous permet de réaliser que ce n’est pas le Coran à lui seul qui fait l’islam, mais aussi le travail que les religieux ont accompli à partir de ce Coran. C’est pour cela que dans mon ouvrage je parle de l’islam révélé, qui est l’islam coranique, et de l’islam construit qui est constitué du premier et de ce que les musulmans lui ont ajouté.
Il faut savoir que l’une des questions qui ont préoccupé les musulmans des premiers siècles était de savoir si le Coran aurait été transmis au prophète par l’ange Gabriel, Djibril, qui l’aurait prononcé avec les mêmes mots et les mêmes phrases, ou si le prophète aurait reçu une inspiration de l’ange Gabriel et si c’est le Prophète qui l’aurait formulé dans la langue de son peuple. Autrement dit, si la Révélation est une inspiration ou un livre qui descend tel quel du ciel. La théorie du Coran incréé qui s’est très rapidement imposée affirme que le Coran est un livre qui existe auprès de Dieu qui l’a envoyé tel quel aux musulmans. Dans mon ouvrage publié en 2017, Islam : quel problème ? Les défis de la réforme, j’explique comment les musulmans ont pris position contre la pensée humaine comme source de connaissance et comment la théorie du Coran incréé a été tissée pour être un obstacle à toute utilisation de la pensée humaine dans le domaine juridique. La théorie du Coran incréé a été tissée pour être un obstacle à toute utilisation de la pensée humaine dans le domaine juridique.
F.A –Vous rappelez l’appel à la fraternité contenu dans le Coran sur lequel se fondent les Frères musulmans nés en Egypte. Or la notion de frère est ambiguë, notre revue l’a analysée il y a un an à l’approche de la Journée internationale de la fraternité humaine organisée à la demande de l’ONU le 4 février pour commémorer la rencontre entre le pape François et le recteur d’al-Azhar Ahmed al-Tayyeb. Y a-t-il une définition robuste de la fraternité en islam ?
Razika Adnani – Le verset 10 de la sourate 49 dit en effet que « Les croyants sont des frères ». Or, un croyant est celui qui a la foi, et le terme « croyants » ne désigne pas uniquement les musulmans, mais également les juifs et les chrétiens pour ne citer que les religions monothéistes. Dans ce cas, logiquement, cette fraternité dont parle le Coran est très large et englobe tous les croyants. Cependant, ce n’est pas ainsi qu’elle est conçue par les musulmans pour lesquels un croyant est celui qui croit en Dieu, en son prophète et en la sacralité du Coran. De ce fait, pour eux, les croyants sont uniquement les musulmans et la fraternité dont parle ce verset est limitée aux musulmans et fondée sur la religion musulmane et non sur le sang ou l’appartenance à l’humanité.
Cependant, la question du sens des deux termes, musulman et croyant, n’est pas résolue. Ibn Taymiyya (1263-1328), par exemple, a affirmé que tout croyant est un musulman mais qu’à l’inverse tout musulman n’est pas croyant. Cela voudrait-il dire que la fraternité dont parle le Coran ne concerne pas tous les musulmans ? Ce qui serait impossible si, pour être musulman, il était nécessaire de croire en Dieu et en son prophète comme l’atteste la profession de foi. Ibn Taymiyya se réfère dans ses propos au verset 14 de la sourate 49 qui demande au prophète de répondre aux Bédouins qui lui ont dit : « Nous avons la foi. » qu’ils n’ont pas la foi et qu’ils doivent seulement dire : « Nous sommes musulmans (aslam-na). ». Si l’on ne peut pas être musulman sans être croyant, c’est-à-dire sans avoir la foi, le sens du terme « musulmans » dans ce verset pose un grand problème.
Tareq Oubrou, dans son ouvrage Appel à la réconciliation : Foi musulmane et valeurs de la République française, explique que ce verset parle des musulmans d’apparence qui n’ont pas en réalité la foi. Cette explication est une reconnaissance de l’absence de liberté de conscience en islam et de la pression que la communauté exerce sur l’individu qui se retrouve obligé d’être un musulman d’apparence. Comment la fraternité peut-elle exister dans ce genre de climat y compris dans la même société ?Certains pensent que le terme aslamna dans ce verset ne signifie pas musulmans, mais « soumis ». C’est l’explication qui me paraît la plus logique et ce n’est pas le seul verset où le terme muslim ne peut pas être traduit par musulmans, mais par soumis ( à Dieu).
Vous dites que le mot frère est ambigu. Pour moi, il n’est pas ambigu, mais il est polysémique. Le « frère » est celui avec qui on partage les mêmes parents tout comme la « sœur » est celle avec qui on partage les mêmes parents. C’est la fraternité du sang. Mais on peut être frères en humanité ou en religion ou encore en autre chose.
La fraternité proclamée par le pape François et le recteur al-Tayyeb n’existe pas pour le moment. Pour qu’elle existe, il faudrait beaucoup d’efforts de la part des musulmans, car même si le sujet est très évoqué par le discours religieux, il ne va pas au-delà de la communauté musulmane. Le document commun signé en 2019 par le pape François et le recteur d’al-Azhar Ahmed al-Tayyeb pour la fraternité en humanité n’est que du papier pour le moment. D’une part, les musulmans ne reconnaissent pas l’égalité en droits entre tous les êtres humains et notamment entre les hommes et les femmes. D’autre part, le 7 octobre 2023, après l’attaque des islamistes du Hamas sur Israël qui a visé des civils, et avant toute riposte israélienne, le recteur d’al-Azhar Ahmed al-Tayyeb a publié plusieurs fois sur son compte X pour exprimer sa joie. Dans l’un de ces messages (supprimé aujourd’hui, mais repris par plusieurs sites arabophones) il a écrit : « Le peuple palestinien nous a redonné confiance, nous a insufflé du courage et nous a redonné la vie alors que nous pensions qu’elle ne reviendrait plus jamais. » Autrement dit, il s’est réjoui du massacre d’êtres humains. Pour que la fraternité se réalise, il faut plus de sincérité et plus d’humanisme de la part de tous. Cela ne veut pas dire que c’est quelque chose d’impossible pour les musulmans, mais que pour cela une remise en cause du discours religieux et un regard critique porté sur leur religion sont nécessaires. La fraternité proclamée par le pape François et le recteur al-Tayyeb n’existe pas pour le moment.
F.A- « La soumission des femmes aux hommes est ce que l’islamisme donne aux hommes comme contrepartie à leur soumission à son pouvoir politico-religieux », affirmez-vous. Pensez-vous que, sans succomber aux dérives du discours occidental, cette « moitié de l’humanité » dont vous faites partie pourra, comme elle semble y aspirer jusqu’en Arabie saoudite ou en Iran, se faire une place dans la société ?
Razika Adnani – Pour s’imposer, l’islamisme, ou l’islam politique, cible toujours en premier lieu les femmes pour la simple raison qu’il est un patriarcat et ne peut exister sans soumettre les femmes à ses règles misogynes. Cependant, l’islamisme est également un totalitarisme et, de ce fait, il ne vise pas uniquement les femmes, mais également les hommes. On oublie toujours de parler des hommes alors que, dans l’islamisme, eux aussi perdent leur liberté politique, sociale, religieuse et morale. Si l’islamisme cible en premier les femmes pour les soumettre à la domination masculine, c’est pour consoler les hommes de la perte de leur liberté. Parce que l’islamisme fait d’eux les maîtres des femmes, les hommes acceptent de s’y soumettre.
La consolation est une stratégie très répandue dans le discours religieux, qui console également les femmes en leur serinant que, si elles ne sont pas égales aux hommes en ce monde, elles le seront dans l’autre monde. L’école française qui a forgé le concept d’islamisme comme islam politique qui n’est pas l’islam, elle aussi a voulu consoler les musulmans et les rassurer au sujet de leur religion. Comme je le dis dans mon ouvrage, on retrouve toujours cette façon de consoler les musulmans pour qu’ils acceptent leur sort. Pour que les femmes se fassent une place dans la société islamique, il faut d’abord qu’elles-mêmes se libèrent des idées reçues qui les tétanisent. Dans mon ouvrage, j’ai cité les plus connues.
F.A –Vous rappelez que l’herméneutique des textes sacrés (tafsir) s’est imposée en islam. Vous citez Yazid, fils du premier calife omeyyade, selon lequel l’exégèse est indispensable pour mettre en pratique les recommandations du Coran. Qui aujourd’hui, au sein de l’islam, est porteur de cette conviction ?
Razika Adnani – J’explique comment l’interprétation, tafsir, du Coran a été imposée dès la mort du prophète. La citation de Yazid est une preuve du débat qu’elle a soulevé d’une part et, d’autre part, de la nécessité d’interpréter. En effet, sans l’interprétation, le Coran serait des mots et des phrases et un livre qu’on récite sans plus. Yazid n’était pas un commentateur du Coran. Était-il pour une interprétation éclairée ? Je ne sais pas. Cependant, dans l’histoire de l’islam, il y a eu des interprétations intéressantes : par exemple celles des mutazilites, qui était fondée sur le raisonnement rationnel. Ce n’est pas celle-ci qui s’est imposée, mais plutôt celle des conservateurs, des littéralistes, des salafistes.
Il faut cependant souligner que le problème qui se pose aujourd’hui en islam ne réside pas seulement dans une interprétation erronée des textes coraniques. Cette position est celle de certains musulmans, qui se veulent réformateurs ou éclairés mais qui considèrent que l’islam ne pose aucun problème, mais que ce sont seulement les musulmans qui ont mal compris son message. Pour eux, de ce fait, la solution réside dans la réinterprétation des textes coraniques ; position que j’ai toujours réfutée. D’ailleurs, elle se heurte à des versets coraniques qu’ils n’arrivent pas à réinterpréter pour leur donner le sens qu’ils veulent. Pour moi, le travail qui est nécessaire aujourd’hui au sein de l’islam doit aller au-delà de la réinterprétation pour concerner le choix des versets qu’il faut mettre en pratique et de ceux qu’il faut négliger.
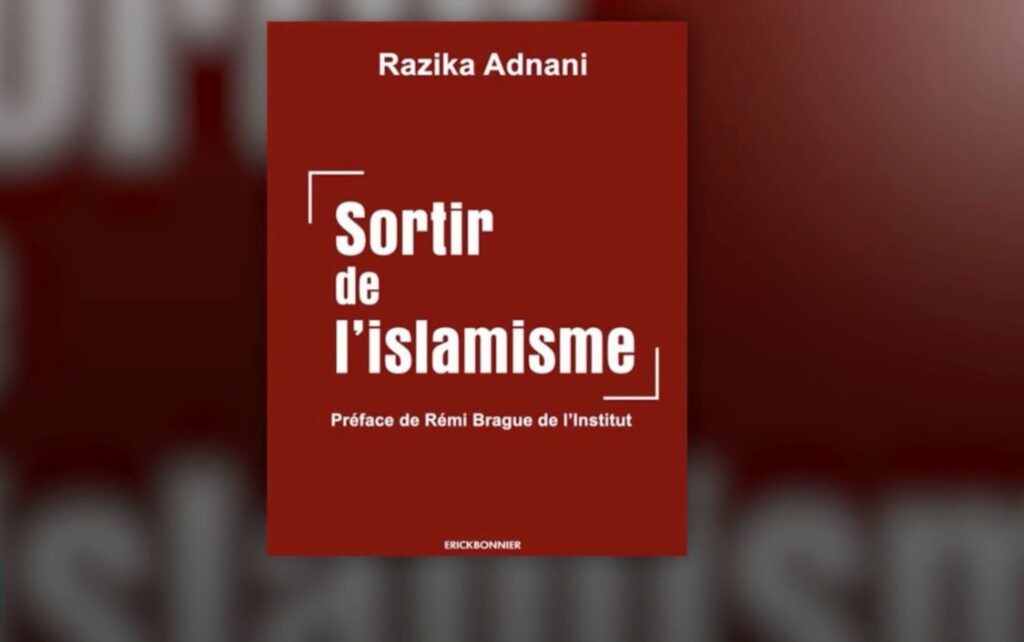
1 Commentaire(s)
Remettre en cause l’islamisme ou l’islam politique, en Occident,en France par exemple tel que expliqué et développé par les universitaires et les chercheurs, sans pour autant reformer l’islam qui, englobe en son sein l’affirmation et son contraire comme le fait de croire ou de ne pas croire. est une perte de temps. Il faut aller à l’origine,a la cause premiere et Mme Razika Adnani à bien expliqué et souligné cette problématique..